Dans Side Affects. On Being Trans and Feeling Bad [affects indésirables. être trans et avoir le seum], le philosophe Hil Malatino réfléchit aux affects négatifs qui accompagnent la transition : plutôt que les récits du bonheur obligatoire et des transitions réussies (avec la pression à la bonne humeur et au succès social qu’elles impliquent), que se passerait-il si l’on faisait place aussi à nos dépressions, à nos dissociations, à la jalousie et à la rage qui nous animent ? Conscient d’écrire depuis une position privilégié (celle d’un mec trans inter blanc et salarié d’une université états-unienne), Malatino cherche à penser du dedans des galères que la majorité des personnes trans* traversons pour trouver là aussi (et pas seulement dans nos euphories de genre) des ressources pour affronter la brutalité anti-trans et le capitalisme patriarcal qui la rend possible. Autrement dit : c’est bien joli d’avoir la joie quand les hormones font pousser les bonnes choses aux bons endroits ou quand on nous genre correctement à la boulangerie, mais qu’est-ce qu’on fait le reste du temps et est-ce que ça pourrait aussi nous donner de la puissance ?
Au bout de son enquête rabat-joie, Malatino finit – au dernier chapitre du livre –par se pencher sur certaines pratiques de guérison trans : celles qui (pour le meilleur) impliquent les usages psychédéliques et (pour le pire) une bonne dose de blanchité. Son examen est à double détente. D’un côté, (c’est l’objet du texte qui suit), il s’intéresse à l’histoire raciale des premiers protocoles de transition (notamment ceux développés par Harry Benjamin) en les situant en relation au « mouvement pour le potentiel humain » – autrement connu sous le nom de mouvement « New Age », qui informe largement la représentation « positive » de certaines personnes trans (blanches) comme des explorateurices curieuses de l’étendue des capacités humaines. Montrant l’adhésion de Benjamin à des idéaux brutalement racistes, Malatino conteste les récits de l’amélioration et de la normalisation défendus par le médecin pionnier des protocoles de transitions hormonales de genre et leur solidarité avec une vision racialisante de l’humanité.
Trou Noir remercie Emma B. pour cette traduction et cette proposition collective de l’histoire trans* de la blanchité.
Dans ce chapitre conclusif, j’examine de manière critique les discours trans qui portent sur la spiritualité, la guérison, la plénitude et le devenir. J’analyse certaines traces historiques retraçant l’implication d’individus et collectifs trans dans la prise de psychédéliques et dans la spiritualité new age, de la correspondance d’Harry Benjamin avec des chercheurs spécialistes du LSD dans les années 1960 et 1970 à la publication trimestrielle Gender Quest, une revue dédiée à la spiritualité trans, au « chamanisme » et aux rituels de guérison dans les années 1990 et 2000. Certains sujets trans – dont le plus célèbre est sans doute le millionnaire, philanthrope et activiste Reed Erickson – se sont tournés vers les psychédéliques à la recherche de moyens pour vivre et explorer des réalités alternatives, souvent en se comprenant eux-mêmes comme supérieurs ou étrangers aux formes hégémoniques de la socialité et de la vie institutionnelle. L’expression psychonaute – un mot qu’on utilisait à l’époque pour décrire les personnes qui se dédiaient à l’exploration de « l’espace intérieur » par l’intermédiaire de psychédéliques comestibles – a même été détournée en gendernaut, dans le titre d’un documentaire expérimental de Monika Treut sur les vies trans à San Francisco à la fin des années 1990. De fait, l’archive trans du dernier XXe siècle est remplie à ras bords de liens – parfois littéraux, parfois métaphoriques – entre les expériences psychédéliques et les expériences de liminalité, de transformation et de transition de genre. Dans les années 1960 et 1970, ces liens ont pris la forme d’une présence trans dans le mouvement dit « New Age », ou mouvement « pour le potentiel humain ». Aujourd’hui, ce rapprochement s’opère par l’intermédiaire des promesses et des visions associées au transhumanisme et au posthumanisme, mais aussi sous la forme de rituels et de pratiques quotidiennes qu’on désigne parfois vaguement aujourd’hui comme woo-woo [1], ainsi que dans la résurgence des recherches universitaires et médicales concernant les usages thérapeutiques des psychédéliques en relation au trauma.

Afin de mieux comprendre l’implication trans dans les expérimentations psychédéliques, la spiritualité new age et les visions utopiques que ces pratiques informent souvent, j’examine les soubassements de cette implication et en particulier la manière dont la corporéité trans y est confondue avec des formes de plasticité et de mobilité profondément informées par la blanchité et imprégnées de privilèges raciaux et d’appropriations culturelles qui se conjuguent avec les discours biomédicaux eurocentriques hégémoniques sur la corporéité trans. Je m’intéresse à cette articulation entre guérison et expérience trans afin de pointer les manières par lesquelles les logiques individualistes néolibérales conspirent avec le capitalisme racial, y compris et précisément dans ces espaces où les sujets sont à la recherche de modes alternatifs d’existence. Je suis curieux de la manière dont les stratégies de désindividuation et les pratiques d’interconnexion restent obstinément limitées par les mécanismes de l’exclusion raciale et par l’exotisation et l’appropriation simultanées des pratiques spirituelles non-occidentales, et j’essaye de comprendre ce que cela signifie pour la guérison trans.
La logique raciale du mouvement pour le potentiel humain
Mais d’abord, faisons un détour par l’archive de Harry Benjamin.
Au printemps 2018, je me suis rendu aux archives du Kinsey Institute pour examiner les archives associées à la Harry Benjamin International Gender Dysphoria Association [association internationale sur la dysphorie de genre Harry Benjamin] (HBIGDA). L’HBIGDA est l’association qui est plus tard devenue la World Professional Association for Transgender Health [association internationale des professionnel·les de la santé transgenre] (WPATH), association qui s’est formée à la fin des années 1970 et qui impliquait principalement des sexologues, des chirurgien·nes et d’autres médecins, psychiatres et clincien·nes, travaillant dans les domaines de la transsexualité et du travestisme. L’association était notamment fondée sur un refus des psychothérapies de « normalisation » et sur la défense d’un modèle chirurgical et hormonal de la transition de genre. La formation de la HBIGDA a consolidé l’autorité et l’emprise de cette approche, mettant un terme à ce que l’historienne Joanne Meyerowitz a appelé la « guerre des prés carrés médicaux » entre les psychologues et les spécialistes de chirurgie et d’endocrinologie [2]. L’association porte le nom de Harry Benjamin en hommage à sa carrière et à son rôle clef dans la légitimation des transitions de genre aux États-Unis. Quand je suis arrivé au Kinsey Institute, il s’est avéré que les archives de la HBIGDA étaient stockées sur un autre site et qu’elles ne seraient disponibles à la lecture que plus tard dans la journée. Shawn Wilson, directeur adjoint de la bibliothèque et des collections spéciales du Kinsey Institute m’a alors suggéré de passer quelque temps avec l’archive de Harry Benjamin en attendant. Et c’est ce que j’ai fait. C’est souvent ce qui arrive avec le travail archivistique : tu trouves des choses inattendues, des matériaux qui détournent voire réorientent entièrement ton itinéraire de recherche. J’imagine que les personnes qui font du travail archivistique ont une prédilection particulière pour ces réorientations et ces surprises de l’archive. Le défi que représente les archives, c’est qu’elles t’imposent de développer des cadres et des concepts pour rendre justice aux complexités de ce qui remonte à la surface ; et cela demande une certaine humilité épistémique. Il faut être prêt à avoir tort et à abandonner les récits historiques et politiques dont on dispose au moment de la rencontre avec ces archives. Cette forme d’humilité épistémique est donc liée à un désir d’être transformé par la rencontre archivistique, d’être capable de rendre compte de mondes discursifs ou de signes qui ne s’organisent pas nécessairement sous la forme des récits hégémoniques ou qui résistent à la narration elle-même. Pour moi, cette relation au travail archivistique s’apparente à une sorte de voyage transtemporel et transpatial aux côtés des fantômes, des traces, de ce qui nous hante ; une interruption des temporalités, en particulier de celle des récits téléologiques du progrès.
Je m’étais rendu au Kinsey Institute dans l’intention de cartographier la formation de la HBIGDA parce que je m’intéressais aux stratégies que l’organisation avait employées pour consolider l’autorité médicale, en particulier en contextes transnationaux. Je voulais comprendre la manière dont la HBIGDA était devenue la WPATH, une association mondiale des professionnel·les de la santé transgenre, une autorité reconnue sur les pratiques recommandées pour les transitions médicales, une organisation dotée d’un pouvoir décisionnel et d’une influence internationales majeures. J’essayais de documenter les manières dont le développement de la WPATH reflétait les cartographies coloniales du savoir et du pouvoir, obéissant à une distinction entre « l’Occident et les autres », où les savoirs et les savoir-faire médicaux, mais aussi les étiologies, les pathologies et les ontologies qui les sous-tendent, font l’objet d’un transfert qui part des lieux de recherche en Amérique du Nord et en Europe de l’Ouest pour s’imposer dans les cliniques du reste du monde. La trajectoire de la WPATH atteste indubitablement de cela ; les archives contiennent une liste des institutions et des praticien·nes qui en sont membres, par année et par nationalité, et sans surprise, la grande majorité des membres de cette organisation censément « mondiale » sont d’Amérique du Nord et d’Europe de l’Ouest. Cette répartition est stable depuis la formation de la HBIGDA. Mais ce que je ne m’étais pas préparé à trouver, et ce que je n’aurais pas trouvé sans le délai d’acheminement des archives de la HBIGDA, c’est la correspondance explicitement raciste entre Harry Benjamin et un certain Robert Masters qui, dans les années 1960, avait co-fondé (avec sa femme, Jean Houston) la Foundation for Mind Research [fondation pour les recherches sur l’esprit] de New York. La carrière de Masters s’est construite sur des écrits concernant les tabous sexuels et les sous-cultures sexuelles minorisées. Il a notamment publié The Homosexual Revolution [la révolution homosexuelle] (1962) – un livre sur le mouvement homophile que la Kirkus Reviews décrit comme « pas aussi flamboyant ou militant que le titre paraît le suggérer » –, Forbidden Sexual Behavior and Morality [moralité et comportement sexuel interdit] (1963), Prostitution and Morality [prostitution et moralité] (1964) et Sex-Driven People [obsédé·es sexuell·es] (1966) [3]. En 1966, il se tourne vers la recherche sur les psychédéliques et sur le LSD ; il co-écrit cette même année The Varieties of Psychedelic Experience [les variétés de l’expérience psychédélique], un volume qui emprunte son titre à l’essai fondateur de William James sur l’expérience mystique. Le sous-titre du livre annonce sa propre importance historique : il se présente comme « le premier guide exhaustif traitant des effets du LSD sur la personnalité humaine ». En 1961, il entame une correspondance avec Benjamin, originellement pour obtenir de lui une préface à Prostitution and Morality et à Forbidden Sexual Behavior and Morality, sans doute en raison de la réputation importante que Benjamin est en train d’acquérir dans la sexologie avec son approche déstigmatisante sur les questions liées à la soi-disant déviance sexuelle ou de genre.
Dans ces premières lettres, il demande notamment l’accès au brouillon d’un livre que Benjamin est en train d’écrire sur la transsexualité (il avait sans doute lu « Transsexualism and Transvestism as Psychosomatic and Somatopsychic Syndromes » [le transsexualisme et le travestisme considérés comme syndromes psychosomatiques et somatopsychiques], paru en 1954, puisque le livre plus connu de Benjamin, The Transsexual Phenomenon [le phénomène transsexuel], où il s’efforce de cis-pliquer la transsexualité aux profanes, ne paraîtrait qu’en 1966). Masters explique que, dans sa vie, il a « eu la chance de rencontrer plusieurs personnes qui croyaient sincèrement être des femmes dans des corps d’hommes », insistant par ailleurs sur le fait qu’il a « aussi connu deux personnes – et en un sens il y a une analogie – qui croyaient fermement être “non-humain·es [4]” ». Il offre ensuite une brève analyse du lien entre trans et non-humain, précisant : « la première impulsion serait de diagnostiquer une schizophrénie, puisque les schizophrènes évoquent souvent de tels sentiments, mais ces deux cas étaient différents, les personnes étaient tout à fait charmantes et capables de s’intégrer au monde [5]. » Dans une correspondance ultérieure, il est clair que Masters s’intéresse à la recherche portant sur les sujets transsexuels, non seulement en tant que sexologue, mais aussi dans le cadre de son intérêt pour les états modifiés de conscience et du schéma psychosomatique. En 1967, il envoie à Benjamin un questionnaire en lui demandant de bien vouloir « le faire remplir par les transsexuell·es et, puisque la comparaison pourrait être intéressante, par les travesti·es également [6] ». Il demande à Benjamin de demander à Virginia Prince – une ancienne patiente de Benjamin et une activiste trans prolifique que Benjamin a aussi employée comme secrétaire – de soumettre ces questionnaires aux patient·es prospectives lors de leurs visites au cabinet, à titre d’appendice aux questions administratives habituelles.
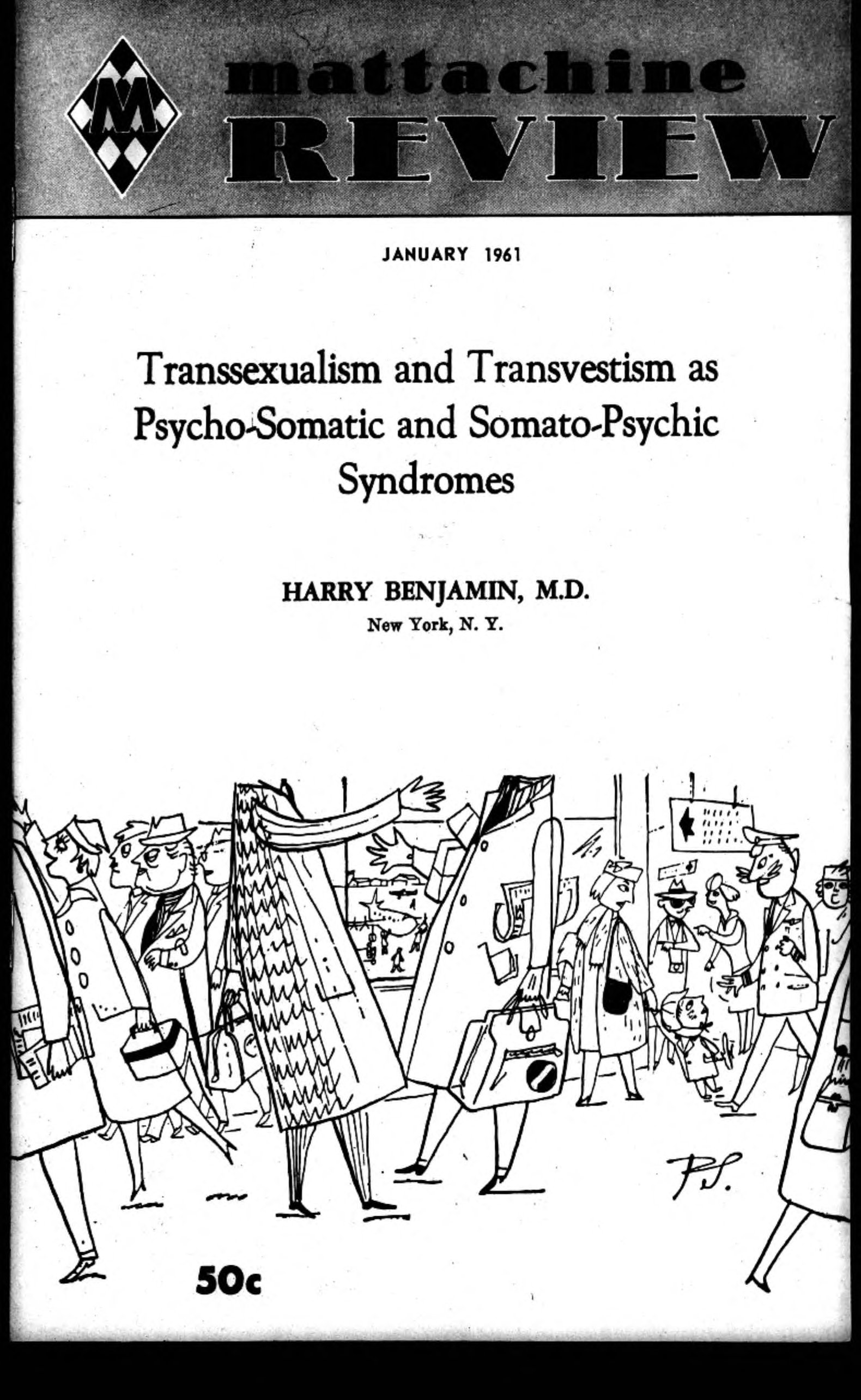
Le questionnaire (qui, pour autant que je sache, n’a jamais été transmis aux patient·es prospectives de Benjamin) portait exclusivement sur l’interface entre transsexualité, travestisme et recherche dédiée au LSD. La première question était : « Croyez-vous que le LSD ait une valeur spécifique pour les transsexuell·es ou les travesti·es ? Si oui, quelle serait cette valeur ? » S’ensuivait des questions concernant le LSD envisagé comme thérapie de conversion pour les personnes trans, demandant aux patient·es de Benjamin si ielles pensaient « qu’une expérience sous LSD était capable de “guérir” les transsexuell·es ou travesti·es » et si ielles étaient intéressé·es par la perspective d’une telle guérison. Et dans le cas contraire, Masters demandait si les personnes avaient quelque intérêt pour le LSD « à des fins thérapeutiques », ou bien « simplement pour l’expérience elle-même », ou encore « comme un moyen de développement personnel » afin de permettre « une meilleure compréhension de soi [7] »
Quand Masters envoie son questionnaire à Benjamin, la recherche sur le LSD connaît un important tournant. Au milieu des années 1960, les chercheureuses cessaient progressivement d’utiliser le LSD dans le but d’induire des états psychotiques ou schizophrènes, reconnaissant que l’état induit par le LSD ne pouvait remplacer la folie. Katherine Bonson, une chercheuse spécialiste des substances contrôlées pour la Food and Drug Administration [haute autorité du médicament et des produits alimentaires], autrice d’une brève et essentielle histoire des recherches cliniques sur le LSD aux États-Unis, affirme qu’« à partir de 1956, le psychiatre canadien spécialiste du LSD Humphrey Osmond avait conclu que le LSD devait être dissocié de l’idée d’induction de l’état de folie. Il créa le néologisme “psychédélique” (au sens de “révélateur de l’esprit”) pour remplacer “hallucinogène” qui connotait, d’après lui, l’idée fausse selon laquelle le LSD produisait un état hallucinatoire proche de la psychose [8]. » En d’autres termes, le LSD était de plus en plus utilisé comme un « adjuvant psychothérapeutique » dont les chercheureuses pensaient qu’il pourrait être utile dans le traitement de la dépression et d’autres irrégularités psychiques ou supposées inadaptations [9]. L’utilisation de cette drogue s’alignait ainsi avec certaines modes dans les pratiques psychologiques à visée humaniste qui mettaient l’accent sur le rôle de « l’inconscient » dans les processus de réalisation et d’accomplissement de soi – ce qui, dans le vocabulaire de l’époque, était renvoyé à l’idée d’atteindre et d’améliorer « le potentiel humain ». Masters s’intéressait à l’utilisation de sujets trans dans la recherche sur le LSD parce qu’il imaginait explorer ou déverrouiller leur potentiel humain et, de manière cruciale, parce qu’il souhait savoir si ce processus pourrait « guérir » leur transitude.
Il peut sembler étrange au regard contemporain qu’on ait pu imaginer que le LSD convainque qui que ce soit de ne pas être trans, mais l’idée selon laquelle le LSD pouvait guérir de l’homosexualité – qui était encore comprise par les psychologues du milieu du XXe siècle comme un désordre psychique enraciné dans des expériences traumatiques infantiles – circulait déjà dans les cercles universitaires qui utilisaient l’acide dans leurs recherches. Cet intérêt pour les logiques curatives connaît une certaine apothéose dans l’entretien tristement célèbre qu’a donné Timothy Leary au magazine Playboy en 1966. Au moment de l’entretien, Leary, qui avait commencé ses recherches sur le LSD à Harvard en 1960, en avait finalement été licencié pour devenir une sorte de figure de gourou de la contre-culture des années 1960. Son évangile tenait en une formule qui fit son succès : turn on, tune in, drop out [allume-toi, branche-toi et lâche prise]. Une partie de ce que Leary entendait par se brancher était apparemment liée à la reconnaissance d’une sorte de vérité cosmique du sexe enracinée dans la philosophie tantrique qui, au moment où il livre son entretien en 1966, imprégnait très largement la métaphysique des recherches sur les psychédéliques : l’idée selon laquelle le chemin vers l’illumination devait passer par une unification soi-disant « profonde » des opposés, rendue seule possible par le sexe cishétéro pénétratif. Jeffrey J. Kripal, spécialiste en études de la religion, parle à ce sujet d’un « mysticisme hétéroérotique » qui s’enracine dans un imaginaire tantrique et qu’on trouve un peu partout dans le mouvement pour le potentiel humain qui émerge des recherches psychédéliques des années 1960 [10]. Kripal considère qu’une des croyances centrales de ce mouvement tient dans l’idée que « la vie mystique… est fondamentalement liée à un retour à l’unité primordiale qui est temporairement perdue en raison de la différenciation biologique des sexes et des injustices sociales engendrées par la construction et les inégalité de genre [11]. » La baise : une des voies du retour à l’unité primaire, pourvu qu’on s’y prenne de la bonne manière. Timothy Leary la décrit dans des termes qui ne laissent aucun doute dans son entretien de 1966 :
Playboy : D’après certains rapports, le LSD serait susceptible de déclencher des pulsions homosexuelles latentes chez certains hommes et chez certaines femmes hétérosexuelles. Est-ce vrai ? Qu’en pensez-vous ?
Leary : Au contraire, le fait est plutôt que le LSD est un traitement agissant spécifiquement contre l’homosexualité. C’est un fait bien connu que la plupart des perversions sexuelles sont l’effet non pas de causes biologiques, mais d’expériences enfantines terrifiantes ou perturbantes d’une manière ou d’une autre. En conséquence, il n’y a rien d’étonnant à ce que de nombreux homosexuels découvrent, sous LSD, qu’ils ne sont pas seulement génitalement mais aussi génétiquement des hommes, et qu’ils sont donc fondamentalement attirés par les femmes. Le cas le plus célèbre de cela concerne Allen Ginsberg qui a déclaré ouvertement avoir été sous LSD la première fois qu’il a ressenti de l’attirance pour une femme. C’était il y a quelques années de cela. Mais il existe de nombreux cas similaires.
Playboy : Est-ce que cela se produit aussi chez les Lesbiennes ?
Leary : J’allais justement en parler. Une fille très attirante est venue à un de nos centres d’entraînement au Mexique [12]. C’était une Lesbienne et elle était très active sexuellement, mais elle dédiait toute son énergie à le faire avec des filles. Elle était dans une session LSD dans un de nos chalets quand elle a décidé de descendre sur la plage. Elle y a rencontré un garçon en maillot bain et là – flash – pour la première fois de sa vie, son énergie cellulaire circulait dans son corps et le lien s’est fait. Ses choix sexuels à la suite de ça ont été quasi-exclusivement des membres du sexe opposé [13].

Si les archives montrent sans ambiguïté que Ginsberg n’a définitivement pas été guéri de son homosexualité par le LSD, et bien que cet entretien ait fait l’objet d’intenses critiques pour sa représentation erronée des dimensions érotiques de l’expérience psychédélique – surtout parce que Leary y affirmait qu’« au cours d’une session LSD préparée avec soin et amour, une femme connaîtra inévitablement des centaines d’orgasmes » –, il n’en représente pas moins le biais cishétérosexiste qui informe la première vague des recherches universitaires sur les psychédéliques [14]. De la croyance selon laquelle le LSD pourrait guérir l’homosexualité à celle selon laquelle il pourrait guérir la transsexualité, il n’y a qu’un pas, dans la mesure où transsexualité et homosexualité étaient toutes deux pensées comme des désordres psychologiques résultant de traumas enracinés dans l’enfance. Il y a quelque chose de révélateur dans l’affirmation de Leary selon laquelle le LSD pourrait servir à révéler la vérité sur le sexe, tant génital que génétique, en permettant une réorientation vers l’hétérosexualité. Dans cet imaginaire, le LSD dévoile les vérités fondamentales du moi et les métaphysiques sexuées et sexuelles de cette vérité s’enracinent dans un microcosme génétique, une sorte d’état idyllique du désir cishétéro d’avant la chute, où l’attraction hétérosexuelle confirme le sexe génétique. Une dose et te voilà dans la matrice hétérosexuelle [15]. Avec ce contexte historique à l’esprit, rien de surprenant à ce que, dans les années qui suivent de l’entretien de Leary, Masters écrive au principal expert connu de la transsexualité pour lui poser des questions sur le rapport que ses sujets entretiennent avec le LSD. Même si sa curiosité se porte sur la capacité du LSD à guérir la transsexualité, il semble aussi plus généralement intéressé par la relation entre l’expérience trans et le potentiel humain, se demandant si les expériences psychosomatiques trans ne pourraient pas détenir la clef d’une forme d’illumination sur l’humain, la liberté ou l’éveil. Masters, comme d’autres personnes qui ont participé au mouvement du potentiel humain, était très affecté par les travaux de psychologues humanistes tels qu’Abraham Maslow, Carl Rogers et Frank Barron qui avaient tous une approche non-pathologisante et qui, contrairement aux psychologues du comportement, ne cherchaient ni à réformer ni à normaliser les sujets en les mettant sur le droit chemin de l’ordre sociopolitique hégémonique. Les mots-clefs des psychologues humanistes sont des mots comme empathie, liberté, transcendance. D’après Masters, le LSD pouvait être utilisé dans le cadre d’une quête d’auto-actualisation. C’est en tous cas ce à quoi il se dédie de plus en plus, notamment au travers de sa Foundation for Mind Research [fondation pour la recherche sur l’esprit] et de la publication qu’il co-dirige, Dromenon : A Journal of New Ways of Being. Un argument supplémentaire du rapport non-pathologisant qu’entretenait Masters à la transsexualité est le fait qu’il fait paraître dans sa revue une critique cinglante de L’Empire transsexuel, un livre de Janice Raymond tristement célèbre pour sa transphobie. Après avoir détaillé avec précision les croyances de Raymond selon lesquelles les femmes trans seraient un complot patriarcal pour infiltrer et prendre le pouvoir au sein du mouvement féministe, sa recension du livre se conclut sur une pseudo-citation de Shakespeare qui décrit L’Empire transsexuel comme « un récit fabriqué de toute pièce par une idiote, plein de bruit et de fureur, mais sans la moindre signification [16]. »
Une manière d’interpréter la correspondance durable entre Benjamin et Masters serait d’y voir un discours entre deux chercheurs avant-gardistes, pionniers d’une approche déstigmatisante des personnes trans, tous deux favorables à la facilitation des transitions et tous deux curieux de ce que l’expérience trans peut nous apprendre sur l’augmentation du potentiel humain, sur l’épanouissement personnel et sur le rôle que l’identité de genre peut jouer dans ce dernier, parfois envisagé comme au-delà des frontières conventionnelles de l’humain (conscience cosmique, unité universelle, union spirituelle sacrée avec le Tout, comme on voudra). L’interface entre psychothérapie au LSD, psychologie humaniste et sexologie trans du milieu du XXe donne ainsi lieu à ce que je propose d’appeler une sous-culture psychédélique trans. Cette sous-culture psychédélique trans se manifeste au travers de multiples terrains de recherche sur le genre et sur le sexe, mais l’idée centrale y est de repousser les limites de la corporéité et de la conscience humaines au travers d’innovations pharmaceutiques et chirurgicales censées améliorer la qualité de vie. Il est important de se rappeler de ce point de vue que Benjamin, avant de se tourner vers la transsexualité, a mené ses premières recherches en gérontothérapie endocrinienne, un champ qui cherchait à améliorer la qualité de vie en repoussant les effets du vieillissement par la thérapie hormonale. Ce phénomène nous est de plus en plus familier, puisque des thérapies de remplacement hormonal sont aujourd’hui fréquemment prescrites aux hommes cis et aux femmes cis péri- ou post-ménopausées, mais Benjamin était un pionnier de ce champ au point d’avoir pratiqué sur lui-même des expérimentations en gérontothérapie endocrinienne, s’injectant quotidiennement de la testostérone jusqu’à un âge avancé.
Masters et Benjamin, tout en étant investis dans l’effort de mettre à l’épreuve les limites de la conscience et de la corporéité humaine au nom d’une amélioration de la vie, étaient aussi profondément racistes. Voilà qui a de quoi soulever des questions sur les entre-implications entre les idéologies de la transformation et de l’épanouissement personnel d’un côté, et celles de la race de l’autre. Cette entre-implication est cruciale dans l’histoire de la sexologie trans. En effet, comme l’a montré Jules Gill-Peterson, le champ de l’endocrinologie, qui joue un rôle déterminant dans l’émergence des technologies de la transition de genre, est aussi profondément marqué par les logiques eugénistes. Gill-Peterson montre notamment comment les physiologistes autrichiens pionniers du champ – Eugen Steinach (qui était un mentor, un collègue et un ami de Harry Benjamin) et Paul Kammerer – ont commencé leurs recherches sur le développement morphologique des rats pour démontrer la manière dont le système endocrinien « sert de médiateur entre l’organisme vivant et son environnement », leur méthode consistant à étudier les modifications du développement corporel sous des conditions environnementales changeantes [17]. Ils découvrent que « les rats élevés sous des températures plus chaudes se développent plus vite que ceux élevés dans les environnements tempérés » et qu’« apparemment ils développent des caractères sexuels secondaires plus importants » qui « apparaissent en outre comme héréditaires [18] ». À la suite de ces observations, les deux auteurs sautent à la conclusion que « les climats chauds sont la cause de l’hypersexualisation qu’on attribue ordinairement aux peuples non-européens parce qu’ils ont encouragé, d’abord, le surdéveloppement des glandes liées à la puberté, et en conséquence, celui des caractères sexuels secondaires [19]. » L’hypersexualisation des personnes qui vivent ou proviennent de ce que les colons européens décrivaient comme des « zones torrides » – c’est-à-dire, les climats tropicaux – a une longue et malheureusement célèbre histoire dans les littératures scientifiques eurocentriques, des histoires naturelles du XVIIIe siècle aux descriptions darwiniennes de la différence raciale. Incessamment, elle est déployée comme une preuve d’arriération eu égard à la hiérarchie eurocentrique du développement civilisationnel. L’hypersexualisation a été liée à la sauvagerie, à la primitivité, à la torpeur, à la fainéantise, au manque de rationalité et de contrôle sur soi. Elle a été constamment déployée comme une justification de la domination coloniale, de l’expropriation et de la violence. Il n’est pas surprenant de voir apparaître cette logique dans la correspondance de Masters et Benjamin, mais cela pose certaines questions quant aux politiques raciales concernant les personnes qu’ils pouvaient considérer comme digne de transitionner et cela explique sans doute en partie pourquoi ils considéraient majoritairement les candidatures de personnes blanches.
Au cours de leur correspondance, dans une lettre datée du 21 août 1965, Masters mentionne les rébellions de Watts, une révolte Noire contre le harcèlement policier et les violences racistes exercées par les forces de police de Los Angeles, qui a été parmi les premières villes des États-Unis à militariser sa police. Il écrit, avec indifférence et nonchalance :
Comment a-t-on réagi face aux révoltes de Los Angeles chez les sauvages de San Francisco ? Pour ma part, je pense que la liberté est un fardeau qui pèse bien trop lourd sur les épaules du N***, et plus il s’en voit chargé, plus le vernis très mince d’occidentalisation dont il s’était recouvert tombe, et c’est comme ça qu’on se retrouve avec des Mau Mau. La débâcle ne fait que commencer, et on n’a encore rien vu [20].
Dans sa réponse datée du 26 août 1965, Benjamin écrit :
Je n’arrive pas à éprouver la moindre compassion, pro-N*** ou autre, concernant ce bourbier à Los Angeles. La faute est sans aucun doute des deux côtés, mais je trouve qu’on ne parle pas assez de l’attitude immature et pour ainsi dire enfantine qui affecte à mon avis une si grande quantité de N*** et qui explique peut-être leur réaction à un sentiment d’injustice qui par ailleurs a probablement quelque justification [21].
Masters et Benjamin déploient des tropes imprégnés de violence raciale et coloniale pour interpréter la rébellion de Watts, des tropes modelés par les idéologies anti-Noires de l’avatisme, de l’anachronisme, du tribalisme et de la primitivité. Masters lie spécifiquement la rébellion de Watts aux révoltes explicitement anti-coloniales des Mau Mau au Kenya, révoltes qu’il décrit non comme une lutte pour la liberté, mais comme une preuve de l’incapacité de la colonisation et de l’occidentalisation à définitivement « civiliser » les personnes Noires. Benjamin reprend à son compte les discours raciaux du retard développemental dans son commentaire sur « l’attitude pour ainsi dire enfantine » d’une « si grande quantité de N*** ». Il est clair qu’à ce moment, au milieu des années 1960, au milieu du mouvement pour les droits civils et alors que les Black Panthers sont sur le point de voir le jour, Masters et Benjamin restent partisans de la logique multiséculaire qui rend le suprémacisme blanc possible en décrivant la culture bourgeoise blanche occidentale comme l’apothéose de la civilisation et en l’ancrant dans des justifications à la fois environnementales, évolutionnistes et héréditaires.
Leur échange soulève plusieurs questions difficiles et lourdes de conséquences pour les chercheureuses contemporain·es qui travaillent à l’intersection des études trans, des études Noires et de la pensée féministe décoloniale. Quelles sont les implications du fait que Benjamin, l’architecte principal des protocoles de transition de genre au tournant du XXe siècle, soit emprunt des épistémologies modernes/coloniales de la race ? Jusqu’à quel point cela nous permet-il de lire les logiques indéniablement hétérosexistes qui déterminaient les candidatures considérées comme viables pour la transition de genre comme des logiques également marquées par les logiques genrées de la blanchité ? Si l’archive de la sexologie occidentale est aussi une archive moderne/coloniale du genre racialisé, comment cette archive atteste-t-elle de la structuration historique de l’accès aux technologies de transition ? Comment ces croyances racistes informent-elles le mouvement pour le potentiel humain et les discours psychologiques et spirituels de l’épanouissement personnel qui y prennent racine et dont sont profondément empreints tant Masters que Benjamin ? Et, pour finir, qu’est-ce que cet héritage implique pour celleux d’entre nous qui nous sentons impliqué·es dans des stratégies décoloniales et transféministes de survie, de résistance et de fleurissement ?
Le fait est qu’il n’y a pas que les sexologues cishétéros à s’être dédié·es aux psychédéliques, à l’expansion de la conscience, à des pratiques corporelles censées augmenter l’espérance de vie et au raffinement des différents degrés d’éveil existentiel et cosmique ; c’était aussi l’esprit du temps, celui d’une contre-culture qui a aussi emporté un grand nombre de personnes trans et qui, de bien des manières, sert de fondement aux pratiques contemporaines de soin dont s’emparent certaines personnes trans en quête de stratégies pour se guérir des effets combinés des traumas, de la marginalisation et de la violence.
***
[Pour continuer la lecture de ce chapitre : Viscosité blanche : les relations entre trans et spiritualité new age]
Traduit de l’anglais (États-Unis) par Emma B.
Texte original : extrait de Hil Malatino, Side Affects. On Being Trans and Feeling Bad, Minneapolis, University of Minnesota Press, 2022, pp. 169-183.
Source de l’image en frontispice : montage à partir d’une photographie de Harry Benjamin à son arrivée à New York en 1913 ; Bain News Service/Library of Congress. L’image figure le buste d’une personne habillée en habits masculins dans un intérieur bourgeois au début du XXe siècle, son visage est pixélisé en une myriade de triangles au milieu desquels ressortent un de ses yeux.
[1] NdT : « Woo » ou « woo-woo » est un terme négatif employé (à partir de 1971) pour désigner les pratiques néo-spirituelles héritées du mouvement New Age, et plus généralement les croyances ésotériques, en particulier quand elles s’intègrent à l’industrie du développement personnel. Il s’agit probablement d’une onomatopée censée renvoyer aux présences fantômes.
[2] Joanne Meyerowitz, How Sex Changed : A History of Transsexuality in the United States (Cambridge, Mass. : Harvard University Press, 2002).
[3] Review of The Homosexual Revolution, by R. E. L. Masters, Kirkus Reviews, May 1, 1962.
[4] Robert Masters to Harry Benjamin, 7 February 1962, box 9, series IIe, folder 9, Harry Benjamin Archives, Kinsey Institute for Research in Sex, Gender, and Reproduction, Inc., Indiana University, Bloomington, Indiana.
[5] Masters to Benjamin, 7 February 1962.
[6] Robert Masters to Harry Benjamin, 28 May 1967, box 9, series IIe, folder 9, Harry Benjamin Archives, Kinsey Institute for Research in Sex, Gender, and Reproduction, Inc., Indiana University, Bloomington, Indiana.
[7] Masters to Benjamin, 28 May 1967.
[8] Katherine Bonson, « Regulation of Human Research with LSD in the United States (1949–1987) », Psychopharmacology 235, no. 2 (2018) : 593.
[9] Bonson, “Regulation of Human Research with LSD,” 593.
[10] Jeffrey J. Kripal, Esalen : America and the Religion of No Religion, Chicago, University of Chicago Press, 2007, 227.
[11] Kripal, Esalen, 221.
[12] Au début des années 1960, Leary a organisé une série de retraites estivales dédiées à la recherche psychédélique à Ziuhuatanejo, au Mexique.
[13] “Timothy Leary,” in Playboy Interviews, Chicago, Playboy Press, 1967, 138–39.
[14] “Timothy Leary,” 134.
[15] Judith Butler, Gender Trouble : Feminism and the Subversion of Identity, New York, Routledge, 1990, 45.
[16] Robert Masters, “Bookmarks,” Dromenon : A Journal of New Ways of Being 2, no. 2 (1979) : 34.
[17] Jules Gill-Peterson, Histories of the Transgender Child, Minneapolis, University of Minnesota Press, 2018, 51.
[18] Gill-Peterson, Histories of the Transgender Child, 51.
[19] Gill-Peterson, Histories of the Transgender Child, 51.
[20] Robert Masters to Harry Benjamin, 21 August 1965, box 9, series IIe, folder 9, Harry Benjamin Archives, Kinsey Institute for Research in Sex, Gender, and Reproduction, Inc., Indiana University, Bloomington, Indiana. NdT : En tant que traductrice blanche, je ne retranscris pas le mot-injure N*** que mobilise ici Masters sans les astérisques ; je choisis aussi de ne pas traduire en langue française pseudo-orale le pseudo-africain-américain que l’auteur emploie dans l’expression finale we “ain’t seen nothing yet”, considérant que ce faux-parler appartient au discours raciste et qu’il n’est pas nécessaire de le faire davantage exister en français pour suivre l’argument.
[21] Harry Benjamin to Robert Masters, 26 August 1965, box 9, series IIe, folder 9, Harry Benjamin Archives, Kinsey Institute for Research in Sex, Gender, and Reproduction, Inc., Indiana University, Bloomington, Indiana.
Une enquête rabat-joie sur la viscosité blanche.
28 février 2022
Entretien à propos de la sortie le 16 mars 2022 du documentaire "Nos corps sont vos champs de bataille".
Un appel décolonial à nommer les ennemies politiques
28 avril 2022
Sur le rapport entre gays occidentaux et hommes arabes
28 mai 2021
Un des fondements du pinkwashing c’est de dire aux gays « venez prendre du plaisir et venez nous soutenir, nous qui sommes la seule démocratie du Proche-Orient et surtout la seule démocratie qui donne des droits aux gays ».
Des formations rocheuses qui défont les visions linéaires et limitées de la transition.
A propos du film « Emilia Pérez » de Jacques Audiard.
Une enquête rabat-joie sur la viscosité blanche.
De la contre-nature à la contre-culture.
