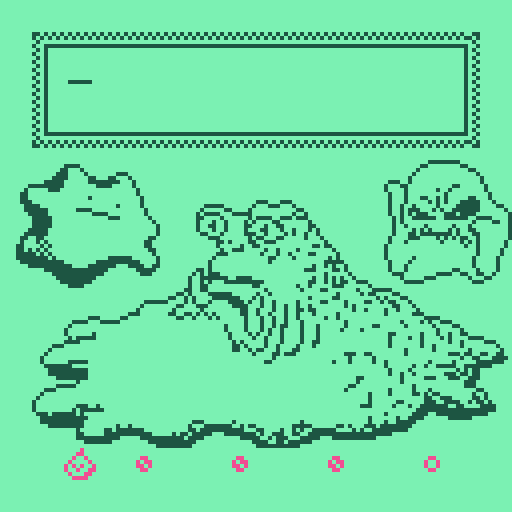Si le trans* est le jumeau maléfique (et donc : oublié ou silencié) du queer, qu’est-ce qui s’y trouve obscurci ? Dans cet article déjà ancien (2004), l’une des fondatrices des études transgenres considère la manière dont le queer, conçu pour être inassimilable par la société hétéronormative, s’est vu absorbé et dilué par les catégories de la différence et de l’identité sexuelle. Où sont donc passées les butchs, les fèms, les pédales, les cuirs, les trans*, les intersexes, les crip, les masculinités et les féminités non blanches que Queer Nation appelaient à la coalition ? Prenant acte de la tendance du queer à se confondre avec les LGB-sexualités, Stryker propose, dans la lignée de son « Discours à Victor Frankenstein sur les hauteurs du village de Chamonix », de revendiquer les promesses des monstres et des inappopriées pour construire des formes d’études trans* coalitionnelles et transverses aux questions de race, de classe, de capacité et de sexuation. Un texte court, topique et encore suggestif pour les études trans* aujourd’hui, qui paraîtra également sur le site de Transgrrrls.
Source de l’image : Velvet, Monstres mous, 2021 ; https://switch-b.itch.io/softness
Si la théorie queer est née de l’union des études sur la sexualité et du féminisme, les études transgenres peuvent être considérées comme son jumeau maléfique : bien qu’elles soient issues de la même lignée, les études transgenres troublent volontairement les histoires que le reste de la famille aime à se raconter, histoires qui privilégient les étiquettes des identités sexuelles (comme gay, lesbienne, bisexuel·le et hétérosexuel·le) et qui délaissent les catégories genrées (comme homme ou femme) pour donner au désir sa forme et ses orientations.
Dans le premier volume de GLQ [1], j’ai fait paraître mon premier article universitaire, « Mon discours à Victor Frankenstein, au-dessus du village de Chamonix : performer la rage transgenre », un article écrit en vue d’une performance et autobiographiquement orienté autour de mes expériences de coming out en tant que transsexuelle. [2] L’article se confrontait à quatre moments théoriques distincts. Le premier était le lien alors récemment établi par Judith Butler entre le genre et la notion de trouble. L’idée que, quand le genre s’absente, la sexualité devient vite incohérente, et que pourtant, celui-ci se refuse à constituer la fondation stable sur laquelle une théorie systématique de la sexualité pourrait s’appuyer. [3] J’avais le sentiment qu’une reprise critique de la transsexualité contenait la promesse d’une contribution signifiante et opportune à cette analyse de l’intersection du genre et de la sexualité. Le deuxième moment théorique était lié à la publication de « L’Empire contre-attaque : un manifeste posttransexuel » de Sandy Stone, un article qui critiquait avec acuité le livre paranoïaque de Janice G. Raymond, L’Empire transsexuel, et appelait les transsexuel·les à articuler de nouveaux récits pour se dire et exprimer plus authentiquement l’expérience transgenre [4]. Je considérais mon propre article sur la rage transgenre comme une réponse explicite à cet appel. Le troisième moment se référait au zine de Leslie Feinberg, Le mouvement de libération transgenre. Feinberg s’était saisie d’un terme préexistant, transgenre, et l’avait investi d’une nouvelle signification, lui permettant de devenir le nom de ce que Stone avait théorisé comme posttranssexualisme [5]. Feinberg proposait de lier le désir d’habiter l’espace transgenre ainsi nouvellement envisagé à une lutte plus large pour la justice sociale. Je me considérais comme une compagne de route. Enfin, je voyais une grande utilité, à la fois politique et théorique, dans le concept nouveau de queerité, conçu comme stratégiquement fluide, post-identitaire et anti-essentialiste. C’était d’ailleurs à l’occasion de ma participation à Queer Nation – en particulier à sa petite sœur de San Francisco, Transgender Nation – que j’avais affûté mes dents théoriques à l’égard de la pratique de la transsexualité.
Quand je suis sortie du placard en tant que transsexuelle en 1992, j’étais particulièrement consciente, expérientiellement et intellectuellement, que les transsexuel·les étions considéré·es comme des créatures abjectes dans la plupart des contextes féministes et gay et lesbiens, et pourtant, je me considérais comme à la fois féministe et lesbienne. Je considérais GLQ comme l’un des principaux véhicules dans la propagation de la nouvelle théorie queer, et je voyais dans la théorie queer un potentiel pour mener une attaque contre le moralisme antitranssexuel qui était incrusté, de manière irréfléchie, dans les analyses les plus progressistes du genre et de la sexualité – attaque qui pouvait se mener, avec le queer, sans avoir besoin de recourir à une contre-offensive réactionnaire, homophobe et misogyne. Je m’efforçai ainsi de dissoudre et de reconstituer le sol que l’identité contribue à genrer à mesure qu’elle plante sa tente. En dénaturalisant et en déprivilégiant les pratiques corporelles et identificatoires non transgenres, et en déployant simultanément un nouveau récit du mariage entre le moi et la chair, j’entendais créer de nouveaux territoires, à la fois analytiques et matériels, pour une pratique transsexuelle refigurée de manière critique. En embrassant et en m’identifiant à la figure du monstre de Frankenstein, en revendiquant le pouvoir transformatif d’une sortie de l’abjection, j’avais l’impression d’avoir trouvé une bonne voie.
Une décennie est passée, et rétrospectivement je réalise aujourd’hui qu’en prenant la parole en incarnant un monstre littéraire célèbre, je n’avais pas seulement trouvé une voix puissante au travers de laquelle offrir une première formulation de théorie transgenre, j’avais aussi trouvé le moyen de me situer moi-même (à nouveau, en tant que monstre de Frankenstein) à l’intérieur d’un drame familial et familier : celui de la personne abandonnée, qui prend revanche sur celleux qui l’ont chassée et qui exprime son désir de rédemption. Je voulais aider à la définition d’un « queer » auquel les transsexuel·les pourraient appartenir. La vision queer qui a animé ma vie (et les vies de bien d’autres personnes qui ont vécu ce bref moment historique du début des années 1990) offrait la perspective éblouissante d’une reconfiguration compensatoire et utopique de la communauté. Le queer paraissait constituer un saut extatique et antiœdipien dans un espace postmoderne de possibilité dans lequel les contenants fondateurs du désir pourraient être enfin brisés, relâchant une puissance érotique brute qui pourrait être captée à la faveur d’un projet social radical. Cette vision continue de me couper le souffle.
Une décennie plus tard, avec un autre Bush à la Maison Blanche et une autre guerre dans le Golfe persique, il est douloureusement clair que la révolution queer du début des années 1990 n’a fait place, au mieux, qu’à quelques formes fragiles et ténues de progrès libéraux qui, contenus à certains secteurs, n’ont pas réussi à transformer radicalement la société – et pas davantage les études universitaires que le reste du monde. La théorie queer s’est transformée en une présence retranchée dans les bastions (généralement progressistes) de l’enseignement supérieur, sans réaliser le potentiel (probablement utopique) que j’y projetais (peut-être naïvement) de restructuration radicale de notre compréhension du genre, en particulier concernant ses manifestations minorisées et marginalisées, comme la transsexualité. Même si les études queer restent l’un des endroits les plus hospitaliers pour travailler les questions transgenres, bien trop souvent le queer reste un nom de code pour signifier « gay » ou « lesbienne », et bien trouvent les phénomènes transgenres sont appréhendés, de travers, sous un angle qui privilégie l’orientation sexuelle et l’identité sexuelle comme modalité première de divergence par rapport à l’hétéronormativité.
Le plus perturbant, c’est que « transgenre » en vient de plus en plus à fonctionner comme le site où se trouve contenus tous les troubles dans le genre, ce qui contribue à sécuriser, à stabiliser et à normaliser l’homosexualité et l’hétérosexualité comme catégories privilégiées de la personnalité humaine. Cela a des corollaires politiques à la fois dommageables et isolateurs. C’est la même logique progressiste qui a transformé la politique anti-assimilationiste queer en un mouvement pour les droits civiques LGBT de meilleur aloi, où le T s’est trouvé réduit à n’être plus qu’un genre d’identité sexuelle (aisément détachable du soi), plutôt que d’être perçu comme la race ou comme la classe, c’est-à-dire comme un élément qui traverse les sexualités existantes, révélant, souvent de manière inattendue, les modes selon lesquelles ces identités produisent leurs spécificités.
Le champ des études transgenres a pris forme, au cours de la décennie passée, dans l’ombre de la théorie queer. Parfois, il a revendiqué sa place dans la famille queer et offert des critiques internes. Parfois, il s’est emporté au point de claquer la porte et de créer ses propres lignées et ses chambres à soi. Quoi qu’il en soit, les études transgenres suivent leurs propres trajectoires et elles ont le potentiel de se confronter à des problèmes émergeant dans l’étude critique du genre et de la sexualité, de l’identité, de la corporéité et du désir, selon des modes que les études gay, lesbiennes et queer n’ont pas toujours réussi à naviguer. Cela semble particulièrement le cas en ce qui concerne la manière dont les études transgenres résonnent avec les études sur le handicap et les études intersexes, deux autres entreprises critiques qui enquêtent sur des formes atypiques de corporéité et de subjectivité et qui, bien qu’elles soient irréductibles à l’hétéronormativité, tombent très largement en dehors du cadre analytique de l’identité sexuelle qui domine si massivement la théorie queer.
À mesure que la mondialisation se présente comme un contexte inévitable au sein duquel nos vies se déroulent, il devient de plus en plus crucial de se rendre sensibles aux manières dont les identités investies par le pouvoir du privilège euro-américain interagissent avec les identités non occidentales. Si l’histoire et l’anthropologie du genre et de la sexualité nous enseignent quelque chose, c’est que la culture humaine a créé bien des manières d’assembler les corps, les subjectivités, les rôles sociaux et les structures de parenté – cet immense appareil à produire des personnalités intelligibles qu’on appelle « le genre ». Il est incroyablement facile de reproduire les structures de pouvoir du colonialisme en subsumant les configurations non occidentales de la personnalité dans des constructions occidentales de la sexualité et du genre.
Cela serait une erreur de considérer les études transgenres comme une théorie queer mieux adaptée à penser le marché mondial intégré – comme si son cadre intellectuel de pensée était moins enclin à exporter les notions d’identités sexuelles, moins enclin à exproprier les configurations non-occidentales de la personnalité. Les études transgenres, elles aussi, sont marquées par le fait d’avoir pris origine dans le « Premier Monde ». Mais la critique que les études transgenres ont offertes à la théorie queer est en train de constituer un point de départ pour une conversation vivace qui implique de nombreux·ses interlocuteurices venues de nombreux espaces, et qui parlent de la mutabilité et de la spécificité des vies et des amours humaines. Un dialogue émergent où continue d’insister un potentiel queer radical qu’il reste à réaliser.
Traduit de l’anglais (États-Unis) par Emma B.
Texte original : Susan Stryker, « Transgender Studies : Queer Theory’s Evil Twin », GLQ, Volume 10, Number 2, 2004, pp. 212-215.
[1] NdT : Le titre complet de la revue est GLQ : A Journal of Lesbian and Gay Studies, revue fondée au début des années 1990 avec pour objectif de « donner une perspective queer sur tous sujets ayant trait au sexe et à la sexualité » et où le Q renvoie à la fois à quarterly (signalant une publication trimestrielle) et aux affects « bagarreurs, trouble-fête, irritables, impatients, sans-gêne, garce et camp » du queer (Carolyn Dilshaw et David M. Halperin, « From the editors », GLQ, vol. 1/1, 1993.)
[2] Susan Stryker, « Mon discours à Victor Frankenstein, au-dessus du village de Chamonix : performer la rage transgenre » (1994), traduit de l’anglais (États-Unis) par Sœur Mahleneriez pour Trrransgrrrls, trounoir.org, #9, 2021 ; http://trounoir.org/?Mon-discours-a-Victor-Frankenstein-au-dessus-du-village-de-Chamonix
[3] Judith Butler, Ces corps qui comptent. De la matérialité et des limites discursives du « sexe », (1993), traduit de l’anglais (États-Unis) par Charlotte Nordmann, Paris, Amsterdam, 2018.
[4] Sandy Stone, « L’Empire contre-attaque : un manifeste posttranssexuel », (1987), traduit de l’anglais (États-Unis) par Kira Ribeiro, Comment S’en Sortir ?, n° 2, automne 2015 ; https://commentsensortir.files.wordpress.com/2015/12/css-2_2015_stone_l-empire-contre-attaque.pdf
[5] Leslie Feinberg, Le mouvement de libération transgenre, (1992), traduit de l’anglais (États-Unis) anonymement, Tarage, 2010 ; https://tarage.noblogs.org/le-mouvement-de-liberation-transgenre-leslie-feinberg/
28 Novembre 2020
Performer la rage transgenre. Par Susan Stryker.
28 mars 2022
« Le barbare est un "bug dans la matrice". Littéralement un "monstre" de la civilisation ».
28 Juin 2020
Lecture de « Je suis un monstre qui vous parle » de Paul B. Preciado